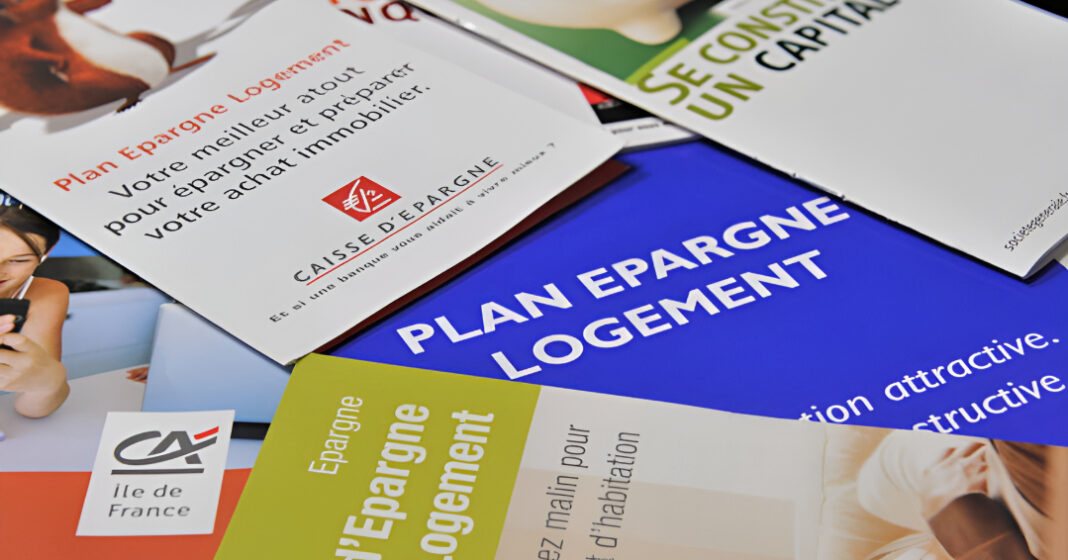Plus de neuf millions de Français détiennent aujourd’hui un Plan Épargne Logement (PEL), totalisant un encours global de 222 milliards d’euros. Conçu initialement comme un moyen de financer un projet immobilier, ce produit réglementé offre également une solution d’épargne à long terme, grâce à des taux historiquement élevés pour les contrats souscrits avant 2011.
Le PEL permet de verser des sommes régulièrement, pendant une durée minimale de quatre ans pour faire naître un droit de prêt. L’emprunt, octroyé à un taux fixe, s’ajoute à la rémunération du plan : le Taux de Prêt Épargne Logement (TPEL) est fixé à 1,2 % au-dessus du taux de rémunération du PEL. Selon le montant accumulé, le montant maximal du crédit peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, dans le cadre de travaux ou d’acquisition.
Au-delà de quinze ans de détention, les PEL ouverts après le 1er mars 2011 font l’objet d’une clôture automatique : les sommes sont soit transférées vers un autre placement, soit converties en livret bancaire classique, dont le rendement moyen s’établit à 0,8 % (source : Banque de France). Les contrats anciens, souscrits avant cette date, restent toutefois actifs jusqu’au retrait des fonds, sans clôture systématique.
Des taux historiques qui défient le marché
Lorsque le PEL est créé en décembre 1969, son taux est fixé à l’ouverture pour l’intégralité de la durée du contrat. Entre juin 1983 et juillet 1984, il s’élève même à 6,30 %. Pour les plans ouverts entre 1986 et 1994, le taux de base atteint 4,62 %, hors prime d’État plafonnée. À titre de comparaison, le Livret A, dont le plafond de versement est plus modeste et les conditions différentes, voit son taux passer de 2,4 % à 1,7 % au 1er août 2025.
Au dernier pointage de la Banque de France, plus d’un quart des PEL actifs (soit 2 millions de comptes) offrent un taux supérieur à 3,5 %. Ces contrats procurent donc un rendement net de tout changement réglementaire, sous réserve d’une imposition sur les intérêts perçus. Les détenteurs d’anciens PEL profitent ainsi d’une rémunération largement supérieure à celle du marché monétaire traditionnel.
Impacts pour les détenteurs et recommandations pratiques
Les bénéficiaires de PEL antérieurs à mars 2011 n’ont aucune obligation de clôture : ils conservent leur produit, tant qu’ils n’effectuent pas de retrait. Le retrait partiel ou total entraîne la fermeture du plan, quelle que soit la date d’ouverture. Pour les PEL postérieurs à 2011, la clôture automatique n’intervient qu’au-delà de quinze ans, sauf demande expresse de l’épargnant.
En 2020, La Banque Postale avait tenté de conditionner la détention d’un PEL à l’ouverture d’un compte payant annuel. L’irritation des clients et l’intervention de l’UFC-Que Choisir ont mené à l’abrogation du dispositif et à la réactivation des plans fermés contre l’avis des épargnants.
Selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2022, les PEL anciens se sont mués en placement à caractère rente, bénéficiant majoritairement à des ménages aux ressources plus confortables, détenteurs d’encours élevés. Les auteurs du rapport soulignent que cette dynamique s’éloigne de l’objectif originel d’accéder à la propriété, creusant un fossé entre les nouveaux entrants, soumis à des conditions de rémunération moins attractives, et les anciens épargnants.
La pérennité des conditions contractuelles protège les détenteurs, mais pèse sur les budgets publics et sur la structure de l’épargne réglementée. Toute tentative de renégociation des taux ou de modification rétroactive des règles exposerait les pouvoirs publics et les établissements bancaires à des contentieux. Les textes encadrant le PEL demeurent figés jusqu’à l’échéance des contrats, offrant un cadre juridique stable pour les épargnants.
À la fin 2024, les PEL antérieurs à mars 2011 représentaient 84 milliards d’euros, contre 107,7 milliards trois ans plus tôt. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse : la clôture volontaire pour besoins de liquidité, la transformation en livret classique après quinze ans pour les contrats récents, et surtout le décès progressif des détenteurs issus des générations les plus âgées.